La langue française se nourrit d’expressions multiples et riches. Quel plaisir de parler ou de raconter une histoire de manière détournée.
Les expressions sont un extrait de la culture d’un pays ou parfois d’une simple région. Lorsque l’on souhaite parler couramment une langue, l’apprentissage des expressions devient alors vite un besoin pour enrichir son discours, mais aussi pour comprendre un natif lorsqu’il parle.
En France, on emploie beaucoup d’expressions françaises liées à une Histoire collective, des spécificités régionales ou encore des légendes traditionnelles.
Le Progrès Egyptien vous propose sous cette rubrique des expressions françaises qui font partie intégrante de la langue de Molière.
• Avoir un coup dans l’aile

Cette expression se dit d’une personne enivrée ou d’un objet défectueux. C’est une expression populaire apparue au XXe siècle qui renvoie à l’image d’un oiseau dont l’une des ailes est abîmée (incapable de s’envoler), et qui de ce fait titube sur le sol de la même manière qu’un ivrogne.
Exemple : Après avoir chuté de vélo, il a eu un coup dans l’aile mais s’en est sorti avec seulement quelques égratignures.
• Faire l’âne pour avoir du son
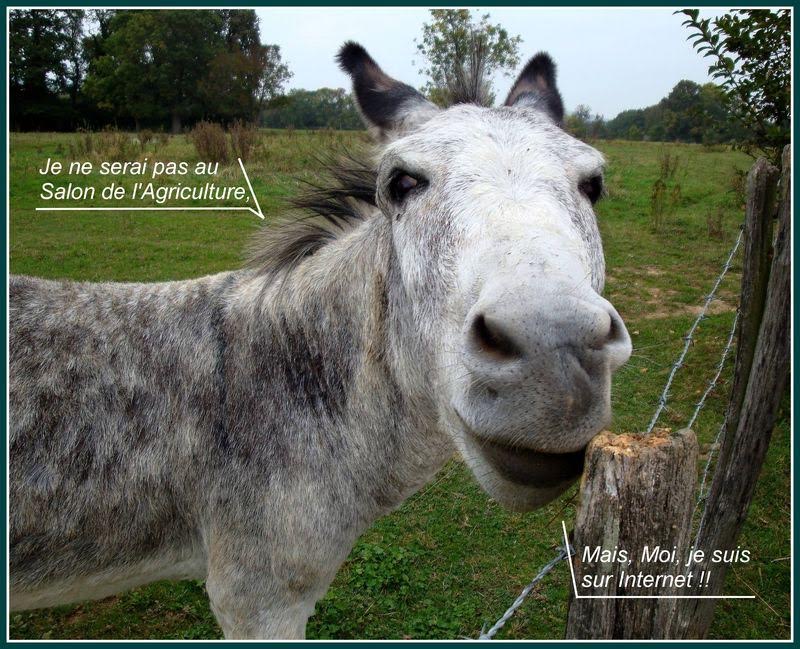
Cette expression veut dire faire le naïf pour obtenir quelque chose, faire l’imbécile pour obtenir ce que l’on souhaite. Cette expression fut employée pour la première fois par Rabelais au XVIe siècle. Il faisait référence à cet animal très entêté capable de braire aussi fort et aussi longtemps que possible jusqu’à l’obtention de sa pitance : le son, une céréale.
Exemple : Arrête de faire l’âne pour avoir du son et dis-moi la vérité.
• Joindre les deux bouts

On utilise cette expression pour faire référence à la gestion de notre budget. Dire qu’on ne réussit pas à joindre les deux bouts signifie que les revenus d’un mois ne suffisent pas à couvrir nos besoins jusqu’aux revenus du mois suivant. C’est en 1560 que la collerette fait son entrée, devenant un accessoire détaché de la chemise et des robes. La forme de fruit qu’elle a à l’origine lui donnera son surnom : la « fraise ». Réservée à la noblesse et à la bourgeoisie, la fraise devient rapidement un signe de réussite, destiné à mettre en avant le rang ou la richesse de celui qui la porte. De fait, la taille de la collerette augmente avec la démesure de l’époque. Certains nobles à la faible fortune, en effet, voulant paraître plus riches qu’ils ne le sont, suivent la tendance en portant des fraises de plus en plus larges. Cependant, la taille des serviettes de table, parfois portées autour du cou lors des festins, ne suit pas proportionnellement cette démesure, pour des raisons de budget. Comme les nobles n’entendent pas ôter leur fraise durant les repas, la serviette s’avère trop petite, et ils ont alors du mal à joindre les deux bouts autour du cou !
Exemple : Depuis qu’il a décroché ce nouvel emploi, il parvient enfin à joindre les deux bouts et à subvenir à ses besoins.






