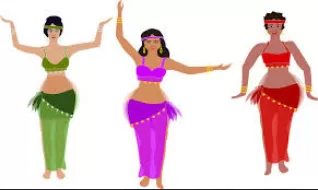Symbole de grâce et d’identité culturelle, la danse orientale a toujours occupé une place singulière dans la société égyptienne. De Samia Gamal à Fifi Abdou, elle a fait rayonner l’image de l’Egypte à travers le monde. Mais son statut, souvent tiraillé entre art et controverse morale, reste source de débats passionnés. L’ouverture récente d’une académie spécialisée dans le raks charqi par la célèbre danseuse Dina ravive aujourd’hui cette vieille querelle entre tradition, liberté artistique et valeurs sociales.

Par : Hanaa Khachaba
L’annonce de l’ouverture d’une académie dédiée à la danse orientale, dirigée par Dina, figure emblématique de cet art, n’est pas passée inaperçue. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées, reflétant une fracture nette au sein de l’opinion publique.
D’un côté, les défenseurs de cette initiative y voient une reconnaissance légitime d’un art profondément enraciné dans l’histoire et la culture égyptiennes. De l’autre, ses détracteurs dénoncent une dérive contraire aux valeurs de la société et à son sens de la pudeur. Pour les partisans de Dina, institutionnaliser l’enseignement du raks charqi est une démarche visionnaire. Ils soulignent que cette danse, née sur les rives du Nil, est bien plus qu’un divertissement. C’est une expression de la féminité, de la joie et de la culture populaire égyptienne.
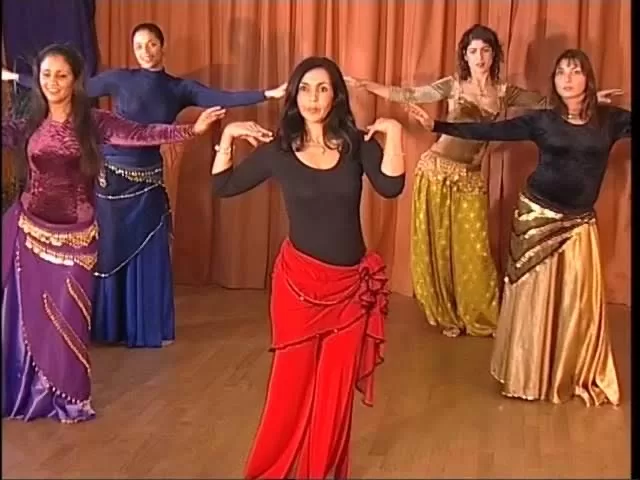
« Il est temps de distinguer la danse orientale authentique des clichés qui l’ont dénaturée », explique une chorégraphe favorable à l’académie. Selon elle, un cadre académique permettrait d’en codifier les techniques, d’en documenter les origines et d’en préserver la dimension artistique.
Certains ajoutent que cette initiative ouvrirait de nouveaux horizons économiques et culturels. Des étudiantes étrangères viennent déjà en Egypte pour s’initier à cet art, participant ainsi à la diplomatie culturelle et au tourisme artistique. D’autres saluent l’effort de Dina pour réhabiliter la danse orientale dans sa dimension éducative et non suggestive, en y intégrant des cours de musique, d’histoire et de mise en scène.
Les opposants, eux, expriment de vives réserves. Pour une frange conservatrice de la société, enseigner publiquement la danse orientale reviendrait à légitimer une pratique jugée contraire aux mœurs. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes dénoncent ce qu’ils perçoivent comme une provocation : « Ouvrir une école de danse du ventre, c’est franchir une ligne rouge », peut-on lire dans certains commentaires virulents.
Ces critiques redoutent également une commercialisation excessive de l’art, qui pourrait le vider de son essence culturelle. D’autres pointent du doigt la hiérarchie des priorités éducatives, jugeant qu’en période de réformes scolaires et économiques, l’Etat devrait plutôt encourager la recherche scientifique et les formations techniques.

Pour eux, la promotion d’une telle académie risque d’envoyer un message ambigu à la jeunesse égyptienne sur les modèles de réussite et la représentation du corps féminin.
Au-delà de la controverse, la question soulevée par cette académie illustre les tensions profondes entre ouverture culturelle et attachement aux valeurs traditionnelles. L’Egypte, berceau du cinéma arabe et de nombreuses formes artistiques, continue de s’interroger sur la place de l’art dans une société en mutation. Une interrogation s’impose donc : Faut-il voir dans l’initiative de Dina un pas courageux vers la reconnaissance d’un art national, ou une atteinte à la sensibilité collective ?
Le débat reste ouvert, mais il révèle une réalité certaine : loin d’être une simple danse, le raks charqi demeure un miroir de l’âme égyptienne, de ses contradictions et de sa quête d’équilibre entre modernité et authenticité.