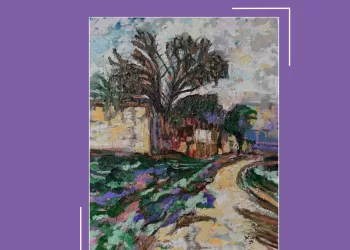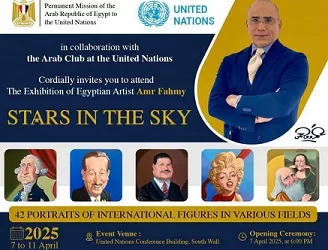Asmaa Abdel-Rahman
Professeur adjoint à l’Université d’Assiout

Les histoires populaires sont l’une des formes les plus répandues de l’art populaire. En effet, les communautés arabes, de manière particulière, et humaine de manière générale y accordent un vif intérêt. Et, les histoires populaires continuent d’être des dépositaires des philosophies, des valeurs, des idées, des mythes des gens. C’est un large réservoir culturel et profond qui a un goût succulent et dont on ne peut se passer. Les histoires apportent un réconfort à travers les temps et les lieux et font face au déluge de la technologie moderne. Ces histoires sont le reflet d’une vague d’événements qui attisent l’esprit humain. Des vagues qui vont et viennent entre fiction et réalité, Mal et Bien, implicite et explicite, virtuel et réalité. Elles sont ainsi, au vrai sens du terme, un miroir de la société et un témoignage sincère sur la vie dans différentes communautés sur les plans culturel et artistique.
Ces histoires constituent un lien commun à toute l’humanité car c’est un texte vivant non silencieux qui s’exprime à travers des images, des couleurs, des événements et des mouvements. Si nous analysons ces histoires, nous nous rendrons compte qu’elles expriment l’humanité dans son ensemble sans distinction tout en reconnaissant la pluralité et le respect d’autrui et révélant parfois, une certaine contradiction. En tout cas, dans les histoires populaires, le lecteur ou l’auditeur ne peut ni reconnaître, ni identifier une quelconque religion ou une autre appartenance identitaire. A peine, les histoires se terminent par l’expression « touta wala maltouta ». Une expression pharaonique héritée de génération en génération. Tout cela rappelle que les différences sont faites par l’homme contemporain. Jamais une histoire populaire n’a exprimé les préceptes ou la croyance islamique ou chrétienne. L’histoire a toujours été un miroir de l’ouverture sur l’autre.