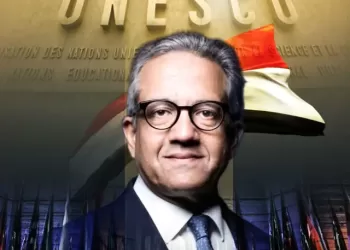Par: Ghada Choucri
La révolution numérique a bouleversé tous les aspects de notre quotidien, et la consommation culturelle ne fait pas exception. L’avènement des plateformes de streaming, qu’il s’agisse de géants comme Netflix et Spotify ou de services de niche, a profondément remodelé nos habitudes, transformant radicalement notre manière d’accéder aux films, aux séries, à la musique et aux podcasts. Ce n’est plus simplement une nouvelle façon de consommer du contenu ; c’est une mutation en profondeur de nos pratiques culturelles, avec des conséquences à la fois fascinantes et complexes.
Par Ghada Choucri
Il y a une quinzaine d’années, l’accès à la culture était encore largement dicté par la notion de rendez-vous. Pour écouter de la musique, il fallait acheter un CD ou se brancher à l’heure sur une station de radio. Pour voir un film, il fallait se rendre au cinéma ou attendre sa diffusion à la télévision. Le streaming a fait exploser ces contraintes temporelles et spatiales, instaurant l’ère du “sur demande”. Désormais, une bibliothèque presque infinie de films, de séries, de chansons ou de podcasts est accessible du bout des doigts, 24 heures sur 24, depuis un smartphone, une tablette ou une télévision connectée. Cette instantanéité a rendu la culture omniprésente et a effacé les frontières entre les genres et les supports. On peut passer d’un documentaire sur l’histoire de l’art à un album de hip-hop, puis à un podcast sur la psychologie, le tout en quelques clics. C’est un buffet culturel permanent, où la seule limite est le temps dont nous disposons.
De la curation à l’algorithme : L’émergence d’un nouveau guide culturel
Avant l’ère du streaming, la découverte de nouveaux artistes ou de nouvelles œuvres était souvent le fruit d’une curation humaine. Les disquaires, les critiques de cinéma ou les journalistes culturels jouaient un rôle de prescripteurs, orientant nos choix et nous faisant découvrir des trésors cachés. Si ces figures existent toujours, leur influence est désormais concurrencée par un nouveau prescripteur, dont l’efficacité est redoutable : l’algorithme. Les moteurs de recommandation des plateformes, basés sur l’analyse de notre historique de visionnage ou d’écoute, nous proposent en permanence des contenus qu’ils jugent pertinents pour nous.
Cette personnalisation extrême de l’expérience utilisateur a ses avantages. Elle nous permet de découvrir des œuvres que nous n’aurions jamais cherchées par nous-mêmes, élargissant potentiellement nos horizons. Pour un amateur de jazz, l’algorithme pourrait suggérer des artistes de blues ou de soul, créant ainsi des ponts entre des genres. Pour un fan de science-fiction, il pourrait recommander des films d’animation japonais ou des séries d’anticipation. Cependant, cette logique a aussi un revers. En nous enfermant dans ce que les spécialistes appellent des bulles de filtre, l’algorithme peut aussi nous priver de la sérendipité, de la découverte fortuite d’un contenu qui ne correspond pas à nos habitudes et qui pourrait nous surprendre. Il tend à confirmer nos goûts plutôt qu’à les bousculer, créant un risque d’homogénéisation de notre consommation culturelle.
La fragmentation de l’attention et le triomphe du binge-watching
L’accès illimité et la personnalisation algorithmique ont profondément modifié notre rapport à l’attention. Là où le visionnage d’une série télévisée était autrefois un événement hebdomadaire, dictant un rythme de consommation collectif, le streaming a introduit le concept du “binge-watching”. Regarder une saison entière de sa série préférée en une seule soirée est devenu une pratique courante, voire une norme pour certains. Cette frénésie de consommation témoigne d’un changement d’état d’esprit : le plaisir réside désormais dans la continuité, dans l’immersion totale, au détriment de l’attente et du suspense.
Cette tendance n’est pas limitée aux séries. Le phénomène est similaire avec la musique, où les playlists algorithmiques ont pris le pas sur l’écoute d’albums dans leur intégralité. On ne se plonge plus forcément dans l’univers cohérent d’un artiste pendant une heure ; on consomme des pistes isolées, jetées dans un flux continu de titres qui se succèdent sans logique thématique ou narrative. Cette fragmentation du contenu rend notre attention plus volatile. On est constamment sollicité par la nouveauté, par le prochain épisode, par la prochaine chanson, ce qui peut paradoxalement réduire notre capacité à nous concentrer sur une œuvre dans sa globalité. La culture devient un flux ininterrompu, et l’idée de prendre du recul pour l’analyser ou la savourer pleinement semble de plus en plus difficile à concilier avec ce rythme effréné.
L’impact sur la création : Entre libération et standardisation
L’impact du streaming ne se limite pas à la consommation ; il a aussi des répercussions majeures sur le processus de création. Pour les créateurs, qu’ils soient cinéastes, musiciens ou podcasteurs, les plateformes offrent une vitrine mondiale et un accès direct à un public potentiellement illimité. De nombreux artistes indépendants ont ainsi pu émerger et trouver leur public sans passer par les canaux de distribution traditionnels. Cette démocratisation de l’accès à la diffusion est une force libératrice, encourageant la diversité des voix et des genres. On assiste à une explosion de formats, avec l’émergence de séries plus courtes, de documentaires plus audacieux ou de podcasts narratifs de haute qualité qui n’auraient probablement jamais vu le jour sur les médias traditionnels.
Cependant, les plateformes ne sont pas des acteurs neutres. Elles sont aussi des studios de production, et leurs choix éditoriaux influencent de plus en plus le contenu qui est créé. Les budgets colossaux alloués à certaines séries originales par les géants du streaming ont rehaussé les standards de production, mais ils ont aussi conduit à une certaine standardisation des formats. Les “blockbusters” de la télévision, avec leurs effets spéciaux dignes du cinéma et leurs castings de stars, sont devenus monnaie courante. La course à la production de contenu original peut aussi pousser à une logique de quantité au détriment de la qualité. La “guerre du streaming”, qui voit chaque plateforme se battre pour le prochain succès mondial, peut inciter les créateurs à s’inscrire dans des recettes narratives qui ont déjà fait leurs preuves, afin d’assurer l’adhésion d’un maximum d’abonnés.
Enfin, si les plateformes de streaming ont rendu la culture plus accessible et plus immédiate que jamais, elles ont aussi bouleversé les équilibres traditionnels. Elles nous offrent une liberté de choix inégalée, tout en nous enfermant potentiellement dans des bulles algorithmiques. Elles encouragent l’innovation créative, mais peuvent aussi, par leur puissance, orienter les modes de production. L’enjeu pour le consommateur de culture d’aujourd’hui n’est plus seulement de choisir ce qu’il veut voir ou écouter, mais aussi de comprendre comment ces plateformes façonnent activement ses désirs et ses habitudes. Le tourbillon du streaming nous invite à une réflexion essentielle sur notre rapport à la culture : la consommons-nous de manière passive ou en sommes-nous les acteurs éclairés ? C’est une question qui restera au cœur des débats culturels pour les années à venir.