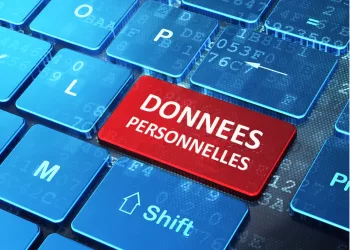Le voyage fait du bien au corps et à l’esprit. En voyageant, on se déconnecte du stress quotidien, on s’éloigne de l’agitation urbaine, on recharge sa batterie.
En fait, une étude indique que le simple fait d’imaginer son prochain voyage serait bénéfique pour la santé mentale, même si la date du départ n’est pas encore fixée.

Certains psychologues vantaient déjà les mérites de la découverte d’une nouvelle destination. De plus, un sondage réalisé aux USA établit un lien entre le voyage et un renforcement de l’attention, de l’énergie et de la concentration.
En fait, planifier et anticiper un voyage peut nous procurer autant de bonheur que le voyage en lui-même, indique National Geographic. Une étude menée par l’Université de Cornell s’est intéressée à la façon dont l’anticipation d’une expérience, par exemple un voyage, peut augmenter considérablement le niveau de bonheur d’une personne.
L’idée est que l’organisation d’un séjour permet d’envisager l’avenir avec optimisme. Cet état d’esprit centré sur le futur peut être une source de joie si nous savons que de bons moments se profilent à l’horizon ; et le voyage est un moment particulièrement joyeux à anticiper.
Plage et vagues, une cure apaisante
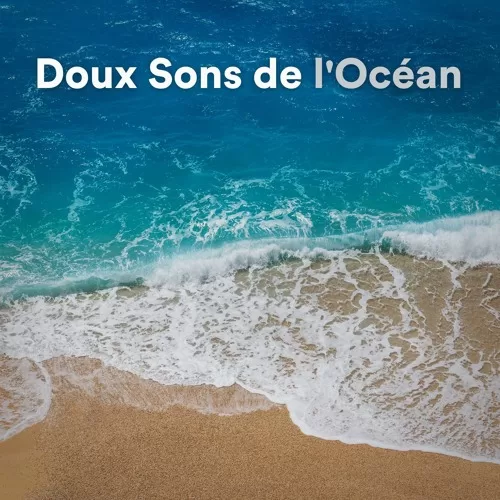
Passer quelque temps au bord de la mer est sans doute un remède au stress de la vie quotidienne. Plusieurs études scientifiques montrent que les espaces naturels « bleus » et donc liés à l’eau seraient associés à un effet apaisant et bénéfique pour la santé mentale.
En écoutant le bruit des vagues, une région du cerveau (cortex préfrontal, associé à différentes fonctions cognitives) est stimulée. C’est un son qui réduit le stress.
En outre, les paysages aquatiques engendrent un apaisement. D’après le magazine « New Scientist » il s’agit d’une « fascination douce ». Contempler la mer et se concentrer sur les bruits des vagues nous apaise Le bleu de la mer et le va-et-vient de l’eau, font oublier les pensées négatives.
Le site « Ouest France » nous apprend que « cette théorie a été décrite pour la première fois à la fin des années 1980 par deux chercheurs, Stephen et Rachel Kaplan, sous le nom de « restauration de l’attention ».