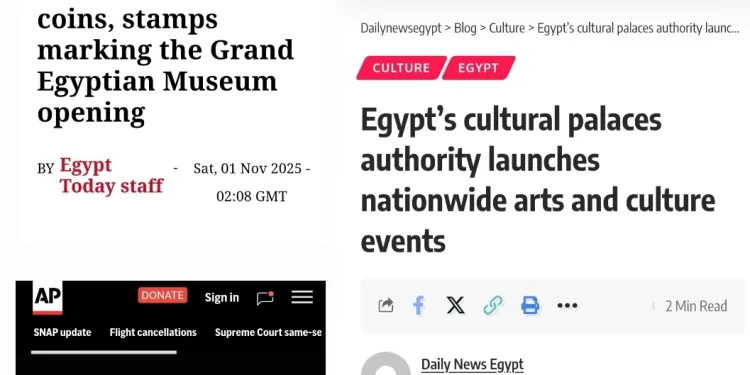L’Égypte multiplie les initiatives visant à renforcer sa présence culturelle et à diversifier ses pôles de développement : l’inauguration grandiose du Grand Musée Égyptien (GME), à Guizeh, marque un tournant dans la promotion du patrimoine et du tourisme ; parallèlement, l’Autorité Général des Palais culturels lance une vaste série d’événements artistiques et littéraires à l’échelle nationale, soulignant l’importance croissante accordée aux régions éloignées du centre. Comment la presse mondiale a-t-elle évoqué ces sujets? En spot…
Par Marwa Mourad
1
L’ouverture du GME: Un nouveau chapitre pour l’Égypte
L’inauguration du Grand Musée Égyptien, près du plateau de Guizeh, n’est pas un simple projet culturel : elle s’impose comme un symbole national et international. Après plus de deux décennies de chantier, l’Égypte révèle un musée consacré à une seule civilisation, abritant des dizaines de milliers d’artefacts (dont la collection complète de Toutankhamun) dans un complexe ultramoderne.
Sous-l’angle économique, cet équipement vise à relancer le tourisme, attirer des millions de visiteurs annuels et générer des devises étrangères ; politiquement, il contribue à rehausser l’image de l’Égypte comme carrefour culturel global et acteur incontournable du patrimoine. Enfin, sur le plan social, il ouvre un voie d’accès accrue à la culture pour les Égyptiens et les visiteurs, en modernisant l’expérience muséale.
Pour que cet élan porte ses fruits, il faudra toutefois assurer une gestion durable des flux touristiques, maintenir la sécurité des collections et veiller à ce que les bénéfices se diffusent au-delà du centre de Gizeh vers les provinces.
2
Une dynamique culturelle nationale via les « palais » d’art
Parallèlement, l’Autorité des palais culturels a mis en place un vaste programme d’arts et de culture dans plusieurs gouvernorats — Le Caire, Alexandrie, Minya, Matrouh… — sous le slogan « Égypte, ton retour au soleil doré ».
Cette initiative traduit une volonté de décentraliser l’accès à la culture, de stimuler les industries artisanales (avec le festival des arts traditionnels à Qena) et de développer des « convois culturels » dans des zones moins urbanisées (village de 28, Banger Al-Sukar à Matrouh).
Elle s’inscrit dans une vision plus large : la culture comme levier de cohésion sociale, de développement régional et d’attractivité touristique domestique. En investissant dans des ateliers, des performances et des rencontres artistiques, l’État pose les bases d’un écosystème culturel durable, capable de générer des emplois, de valoriser les savoir-faire locaux et de renforcer l’identité nationale. Cette stratégie accentue la notion que « le tourisme ne se limite pas aux pyramides », mais que chaque région peut être un acteur actif de l’économie culturelle.
3
Complémentarité : Tourisme de prestige et culture populaire
La conjonction de ces deux volets — un musée de prestige international et un maillage d’initiatives culturelles à l’échelle locale — permet à l’Égypte d’adopter une stratégie à deux niveaux. D’un côté, le GME attire l’attention mondiale, renforce la marque « Égypte » et capte les touristes haut de gamme ; de l’autre, les programmes de proximité renforcent la base nationale, propulsent les arts et favorisent la diffusion des retombées vers les régions.
Cette complémentarité est essentielle : la grandeur symbolique sans enracinement local risque d’être perçue comme isolée, alors que seul le développement régional sans axe fédérateur peut manquer d’attractivité internationale. En favorisant l’articulaton entre patrimoine d’exception et dynamisme culturel local, l’Égypte semble bâtir une plateforme de développement plus équilibrée — ce qui est encourageant à court terme pour le tourisme, la culture et l’économie, et à plus long terme pour la diversification et la stabilité.
Néanmoins, la réussite dépendra de la capacité à traduire ces annonces en retombées concrètes : infrastructure de soutien, formation, intégration des capacités locales, mesure des impacts.