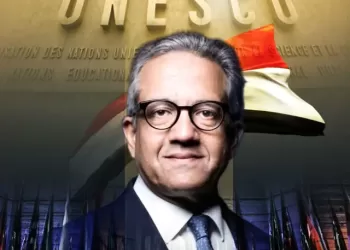À l’heure du numérique triomphant, où le savoir semble flotter dans le nuage à portée de clic, une question se pose avec insistance : les bibliothèques ont-elles encore un avenir ? Elles, ces institutions millénaires, autrefois temples du savoir et de la mémoire collective, peuvent-elles résister à la dématérialisation galopante des contenus, à la tentation du tout digital, à la vitesse effrénée de l’information éphémère ? Faut-il pleurer leur disparition annoncée ou croire à leur métamorphose ?

Le mythe d’une extinction programmée
Pour certains, la bibliothèque est déjà une relique. À quoi bon se déplacer pour consulter un livre quand on peut le télécharger instantanément sur une liseuse ? Pourquoi s’asseoir dans une salle de lecture silencieuse alors que podcasts, vidéos et articles sont disponibles à foison, partout et tout le temps ? Cette vision technophile, parfois radicale, fait de la bibliothèque un vestige, condamné à disparaître comme les cabines téléphoniques ou les vidéoclubs.
Mais cette conclusion hâtive oublie une chose essentielle : la bibliothèque n’est pas seulement un lieu où l’on entrepose des livres. Elle est un espace de vie, de transmission, de lenteur, d’accès équitable au savoir et de lien social. Elle incarne une autre manière d’être au monde, en opposition à la frénésie des flux numériques.
La bibliothèque en mutation
En réalité, plutôt que de mourir, la bibliothèque se transforme. Elle s’ouvre, s’adapte, innove. Elle devient hybride, mêlant collections physiques et ressources numériques, accueillant des conférences, des ateliers, des expositions, des cafés littéraires, des espaces de coworking.
Certaines bibliothèques intègrent même des technologies immersives, comme la réalité virtuelle, pour enrichir l’expérience de lecture ou d’apprentissage. D’autres proposent des fab labs, des studios d’enregistrement ou des imprimantes 3D. Elles deviennent ainsi des tiers-lieux, des carrefours de savoirs, de créativité et de rencontres.
Un rempart contre les inégalités
Dans un monde où l’accès à Internet reste inégal, où la fracture numérique marginalise des millions de personnes, les bibliothèques publiques jouent un rôle crucial d’inclusion. Elles offrent un accès gratuit à l’information, à la culture, à la formation continue. Pour les étudiants, les chercheurs, les enfants des quartiers défavorisés, les personnes âgées, elles sont souvent le dernier bastion d’un savoir partagé.
Plus encore, elles permettent une forme de résistance : celle de la lenteur, de la concentration, du silence, face à la tyrannie de l’immédiateté. Entrer dans une bibliothèque, c’est suspendre le temps, c’est accepter de chercher, de feuilleter, de s’immerger. Une expérience que les algorithmes ne peuvent offrir.
Une question de société
Alors, existeront-elles encore à l’avenir ? Oui, si nous le décidons collectivement. Car leur survie dépend de nos choix politiques, économiques, culturels. Si nous croyons encore à la transmission, à l’accès libre à la connaissance, à la rencontre entre les générations, alors les bibliothèques ont de beaux jours devant elles.
Elles ne seront peut-être plus les mêmes qu’hier. Mais elles continueront à incarner cette idée essentielle : le savoir n’est pas un produit, mais un bien commun. Et tant qu’il y aura des femmes et des hommes pour le défendre, les bibliothèques vivront.
Pourquoi les jeunes désertent-ils les bibliothèques ?

Pendant longtemps, la bibliothèque a été un refuge pour les étudiants, un lieu d’étude silencieux, d’exploration intellectuelle et de concentration. Pourtant, dans de nombreux pays, on constate aujourd’hui une désaffection croissante des jeunes pour ces lieux autrefois incontournables. Les allées désertes, les chuchotements devenus rares, les fauteuils inoccupés soulèvent une question essentielle : pourquoi les jeunes désertent-ils les bibliothèques ?
Une question de temps et d’habitudes
La première raison est sans doute la transformation des habitudes de consommation du savoir. La génération Z est née avec Internet. Elle a grandi avec Google, Wikipédia, YouTube et les réseaux sociaux. Accéder à une information ne demande plus un déplacement physique ni une recherche méthodique : un mot-clé, un clic, et la réponse apparaît. Le savoir est devenu immédiat, fragmenté, décontextualisé, mais infiniment accessible.
Dans ce contexte, la bibliothèque apparaît comme lente, parfois archaïque, figée dans un autre temps. Le rituel de la recherche documentaire, le classement par cotes, le silence imposé, tout cela semble à contre-courant d’un monde où tout est hyperconnecté, rapide, interactif.
L’ombre du numérique
La dématérialisation joue un rôle central. Aujourd’hui, les livres, les articles scientifiques, les thèses, les revues, les cours… sont souvent disponibles en ligne. Les plateformes universitaires donnent accès à des bibliothèques numériques puissantes. Pourquoi alors se déplacer ? Pourquoi s’astreindre à des horaires d’ouverture ? Pour beaucoup de jeunes, la bibliothèque semble obsolète, puisqu’elle est désormais dans leur poche, sur leur téléphone ou leur ordinateur.
Un lieu parfois perçu comme rigide
Il y a aussi l’aspect symbolique. Pour certains jeunes, surtout issus de milieux populaires, la bibliothèque peut représenter un lieu codifié, intimidant, voire élitiste. Le silence y est imposé, le comportement contrôlé, les interactions sociales limitées. On y attend un certain type d’attitude, un certain rapport au savoir. Cela peut décourager ceux qui ne s’y sentent pas légitimes ou qui ne s’identifient pas à ces codes.
De plus, le manque de convivialité de certaines bibliothèques peut rebuter. Peu d’espaces collaboratifs, peu de zones de détente, peu de souplesse dans les usages. À l’heure où les jeunes privilégient des espaces flexibles, chaleureux, où ils peuvent à la fois travailler, discuter, se détendre, la bibliothèque traditionnelle peine à séduire.
Une mutation pas toujours achevée
Face à cette désaffection, de nombreuses bibliothèques tentent de se réinventer. Certaines deviennent de véritables tiers-lieux, mêlant espaces de travail collaboratif, cafés, studios de création, accès à des outils numériques, animations culturelles. On y vient pour lire, certes, mais aussi pour apprendre autrement, pour créer, pour échanger. Pourtant, cette transition est encore inégale. Dans de nombreuses régions, la bibliothèque reste un lieu figé, sans innovation, sans ouverture.
Il faut dire que cette mutation demande des moyens, des formations, et surtout une vision de ce que doit être la bibliothèque au XXIe siècle : non plus un sanctuaire du passé, mais un carrefour vivant de savoirs, de pratiques et de rencontres.
Le besoin persistant d’un lieu de mémoire
Pourtant, malgré cette désertion, la bibliothèque reste un lieu irremplaçable. Elle offre ce que les algorithmes ne peuvent fournir : une cohérence, une hiérarchisation de l’information, une rencontre avec l’inattendu. Dans une bibliothèque, on peut tomber sur un ouvrage par hasard, croiser un regard, ouvrir un livre dont on ignorait l’existence.
Elle est aussi un espace d’égalité, où chacun peut accéder gratuitement à la connaissance, quel que soit son parcours, son milieu, ses ressources. À l’heure de la marchandisation de l’éducation et de la surinformation, cet accès libre et encadré est plus précieux que jamais.
Fuient-ils vraiment, ou attendent-ils autre chose ?
Alors, les jeunes désertent-ils les bibliothèques ? Oui, dans leur forme figée, dans leur inertie. Mais ils n’ont pas déserté le savoir, ni la lecture, ni l’envie d’apprendre. Ce qu’ils fuient, c’est un modèle de bibliothèque qui ne leur parle plus, qui ne reflète ni leur monde ni leurs usages.
Il revient donc aux institutions de repenser ces lieux non pas comme des temples poussiéreux, mais comme des espaces ouverts, pluriels, vivants, capables d’accueillir les jeunes tels qu’ils sont, et non tels qu’on voudrait qu’ils soient.