La langue française se nourrit d’expressions multiples et riches. Quel plaisir de parler ou de raconter une histoire de manière détournée.
Les expressions sont un extrait de la culture d’un pays ou parfois d’une simple région. Lorsque l’on souhaite parler couramment une langue, l’apprentissage des expressions devient alors vite un besoin pour enrichir son discours, mais aussi pour comprendre un natif lorsqu’il parle.
En France, on emploie beaucoup d’expressions françaises liées à une Histoire collective, des spécificités régionales ou encore des légendes traditionnelles.
Le Progrès Egyptien vous propose sous cette rubrique des expressions françaises qui font partie intégrante de la langue de Molière.
- C’est la croix et la bannière
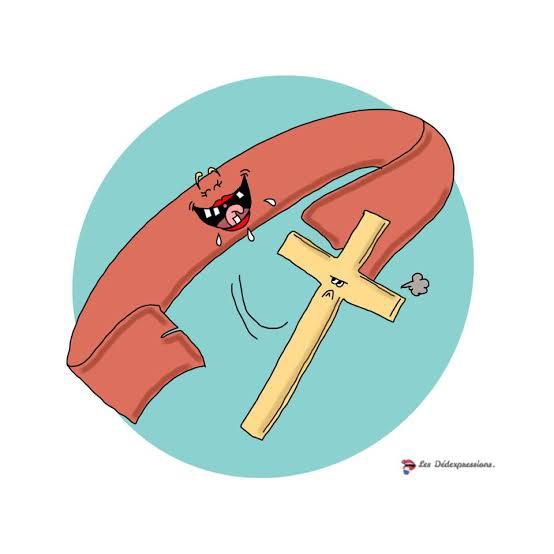
Cette expression fait référence à quelque chose de difficile. Cette expression d’origine italienne date du XVe siècle. Lors de processions religieuses, la croix était placée à l’avant du cortège et les personnes portaient des bannières. Ces processions étant difficiles à organiser, on comprend que cette expression désigne des complications ou des difficultés.
Exemple : Mon enfant est souvent scotché à son smartphone, c’est la croix et la bannière pour le convaincre de s’en passer pour faire une autre activité.
- Aller à vau-l’eau

Dès le XIIe siècle, aller à val ou à vau voulait dire « en descendant le long, en suivant la pente de », un vau étant une vallée (on retrouve d’ailleurs ce terme dans l’expression par monts et par vaux). Au moins jusqu’au milieu du XVIe, cette locution avait le sens très concret de « suivre le fil de l’eau » ; c’est à partir de cette période que son sens abstrait commence à apparaître. On emploie être à vau-l’eau pour désigner une entreprise qui fonctionne mal, et entre le mauvais fonctionnement et la perte ou la faillite, il n’y a qu’un petit pas qui a vite été franchi. Bref, « aller à vau-l’eau » signifie aller en se dégradant ; aller à sa perte ; partir à la dérive.
Exemple : La tristesse de M. Folantin ne se dissipa ; il se laissait aller à vau-l’eau, incapable de réagir contre ce spleen qui l’écrasait.
- Être dans les cordes
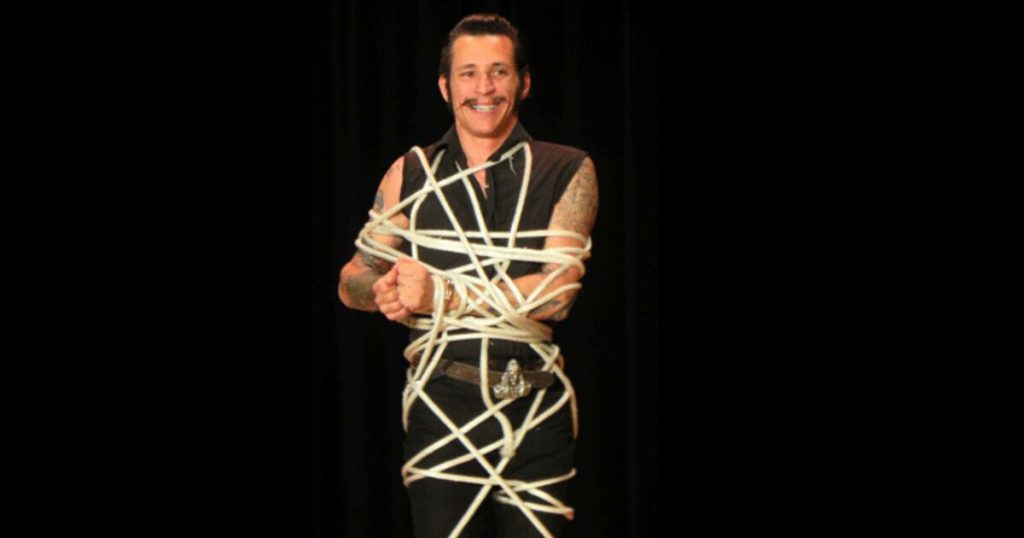
Une expression qui a fait son apparition au début du XIXe siècle et se rapporte au domaine musical. A cette époque, le terme désignait en effet les cordes vocales et faisait allusion au registre d’un chanteur. Les critiques pouvaient ainsi, par exemple, estimer que la voix d’un interprète était belle dans les aigus, c’est-à-dire dans les «cordes élevées». A l’inverse, on pouvait aussi dire qu’une personne était apte à bien chanter dans les graves, donc dans les «cordes basses».Avec le temps, cette expression a peu à peu quitté la sphère musicale pour être utilisée dans tous les domaines. « Être dans les cordes » s’emploie donc lorsqu’une personne se sent capable de réaliser une performance ou d’atteindre l’objectif qu’elle s’était fixé. Elle peut dire « c’est dans mes cordes ».
Exemple: Je peux te donner un coup de main dans la traduction, c’est dans mes cordes.






