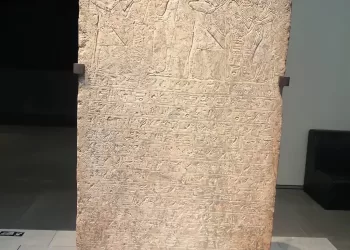Editorial. C’est peu de dire qu’ Haïti, dont le président, Jovenel Moïse, a été assassiné, mercredi 7 juillet, est un Etat qui a failli. La malédiction semble frapper ce pays de 11 millions d’habitants qui partage, avec la République dominicaine, l’île d’Hispaniola et qui fut, avec les Etats-Unis, la première nation indépendante des Amériques. Dictatures, coups d’Etat, corruption, tremblements de terre, cyclones et épidémies ont entretenu depuis des décennies la misère et l’insécurité d’une population impuissante.
L’assassinat d’un chef d’Etat élu est en soi un traumatisme politique majeur.
Il est encore plus déstabilisant lorsque, comme c’est le cas à Haïti, il intervient dans un vide de pouvoir quasi total. Jovenel Moïse fut d’ailleurs l’un des artisans de cette faillite politique, gouvernant par décret depuis janvier 2020 après avoir échoué à organiser des élections législatives.
Le pays n’a plus ni Parlement ni Cour suprême en état de fonctionner. Il compte en tout et pour tout dix élus nationaux, dix sénateurs.
Accusé d’avoir utilisé les gangs armés, seul secteur apparemment florissant à Haïti, pour se maintenir au pouvoir, le président pourrait bien en avoir été lui-même victime. (…) Cette nouvelle tragédie à Port-au-Prince contraint la communauté internationale, et tout particulièrement les Etats-Unis, premier donateur d’aide à Haïti, à se poser quelques sérieuses questions.
Les centaines de millions de dollars dépensées depuis des dizaines d’années pour tenter de stabiliser le pays et sa démocratie n’ont servi à rien, ou presque.
Il faut d’évidence prêter assistance aux Haïtiens, mais le moment est de nouveau venu de s’interroger sur la manière de le faire (…).